Jusqu’au 25 mai 2026
Musée de l’Homme, place du Trocadéro, Paris 16e
Le musée de l’Homme propose de regarder la mort en face – à l’encontre des coutumes occidentales modernes – à travers la présentation de sa collection de momies, replacée dans son contexte historique et géographique. Une exposition à la fois fascinante et troublante !

Le Muséum conserve une grande collection de restes humains, dont 18 000 crânes et 70 corps momifiés. Ces derniers révèlent des méthodes de rites funéraires liés à la conservation des corps différentes selon les continents.

Différentes techniques permettent de préserver les corps. Le tannage, pratiqué en Europe du Nord, consiste à bloquer l’action destructrice des enzymes et des bactéries par un milieu acide comme les mousses des marais ou des cercueils en chêne. La dessiccation par le chaud (chaleur du soleil et pouvoir absorbant de l’eau par le sable) a été observé dans le désert du Taklamakan en Chine. Le froid intense permet également une « cryodessiccation » (Alpes, Groenland, Andes). Enfin, l’injection de produits antiseptiques ou desséchants (formaldéhyde) et l’ablation de certains organes permettent de supprimer l’eau et les micro-organismes pour conserver les corps.
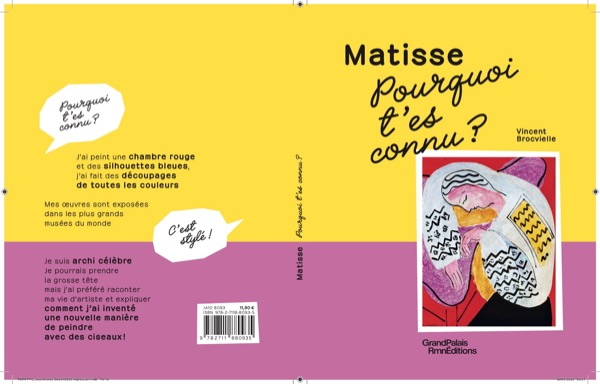
L’embaumement le plus connu est celui pratiqué en Égypte. Mais l’exposition va plus loin en présentant d’autres cultures comme celle de la Sicile baroque, de la France du 19e siècle, ou des Tojara en Indonésie contemporaine. Sans oublier les momies politiques en Chine ou en Russie (Mao, Lénine) qui ont donné lieu à un véritable culte.
Dans certaines communautés, comme les Anga de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les défunts sont encore momifiés puis exposés dans les villages pour continuer de participer à la vie de la communauté, et devenir des gardiens des vivants.

L’essor de l’archéologie au 18e siècle puis des musées ont entraîné un déplacement et un commerce des corps momifiés. Ils ont été découverts principalement en Égypte, comme Myrithis, jeune fille exhumée lors des fouilles de la nécropole d’Antinoé. Ou en Amérique latine telle « la jeune femme des Andes », pour laquelle les scientifiques cherchent encore des indices de son passé.
Le parcours aborde également les problèmes déontologiques : comment conserver et exposer des restes humains ? Doit-on rendre les corps qui ont été déplacés lors des campagnes de fouilles comme celles de Napoléon ?
L’exposition se termine sur l’étude des corps momifiés par les scientifiques aidés des techniques d’imagerie médicale et de biochimie. Avec en contrepoint une oeuvre de Jean-Michel Alberola, représentant un crâne vide créé à partir du néon « rien » (Rien, 2013).
Intrigante, parfois dérangeante, l’exposition nous met face à notre finitude. Elle interroge in fine notre rapport à la disparition, et à la mémoire.
